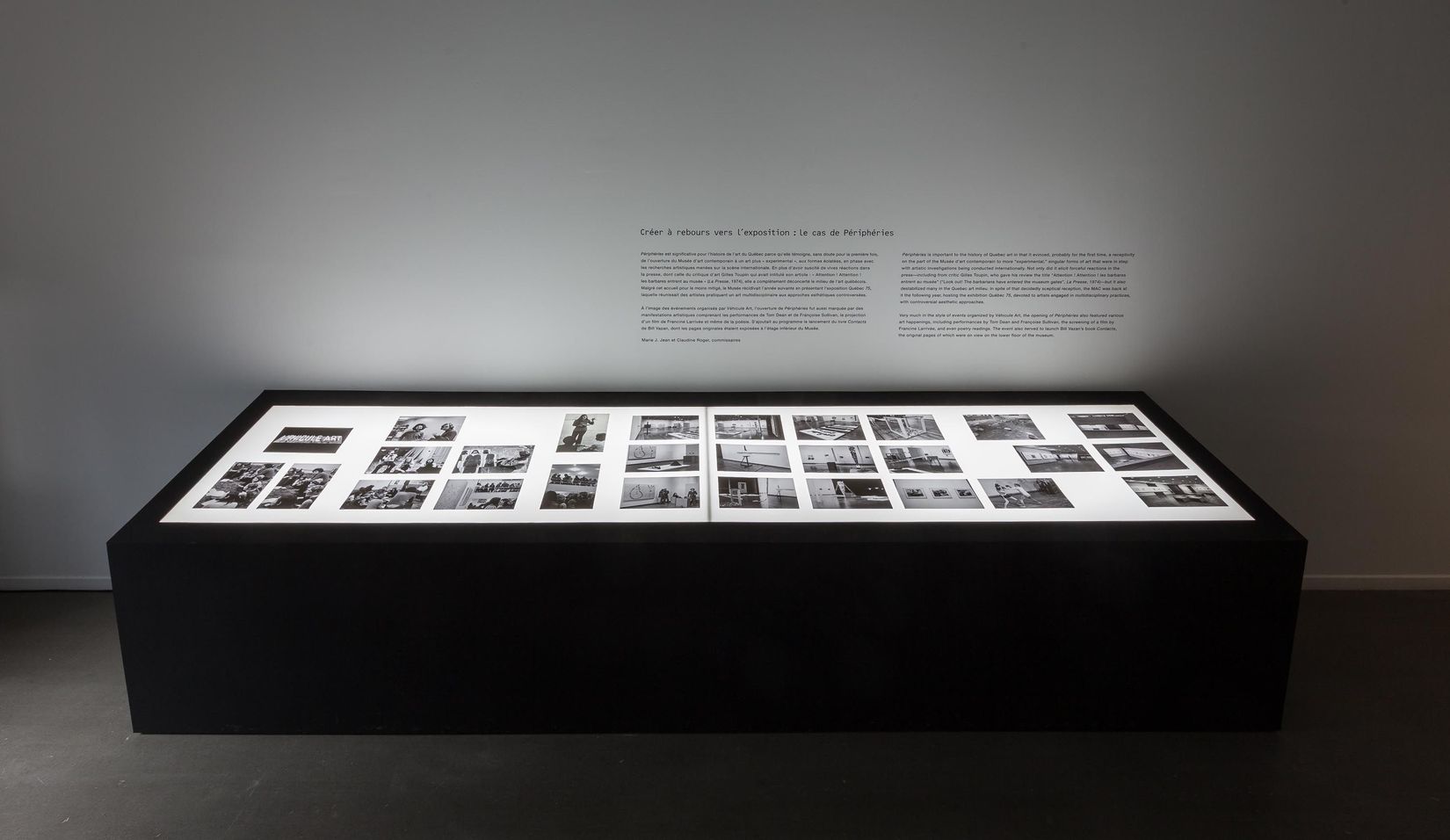Créer à rebours vers l’exposition
Le cas de Montréal, plus ou moins ?
2018.04.19 - 06.30
Cette réactivation documentaire est la quatrième exposition du chantier de recherche sur l’histoire des expositions au Québec, Créer à rebours vers l’exposition, initié par VOX. Elle est conçue et réalisée dans le cadre du séminaire « Exposition, interprétation et diffusion », offert à l’Université du Québec à Montréal dans le programme conjoint de maîtrise en muséologie.
Montréal, c’est nous autres. L’accent est mis sur une ville qui est d’abord celle des gens. Sur une ville retrouvée dans les rues, les parcs, les signes, les graffitis, l’eau que l’on boit, la vie qu’on y mène1.
Organisée par Melvin Charney, artiste, architecte et urbaniste, Montréal, plus ou moins ? s’est tenue au Musée des beaux-arts de Montréal durant l’été 1972, en pleine fièvre sociale d’un Québec post-crise. L’événement se présentait au public comme une « exposition-forum » : un rassemblement de paroles citoyennes et d’œuvres bricolées dans l’urgence de se réapproprier la ville.
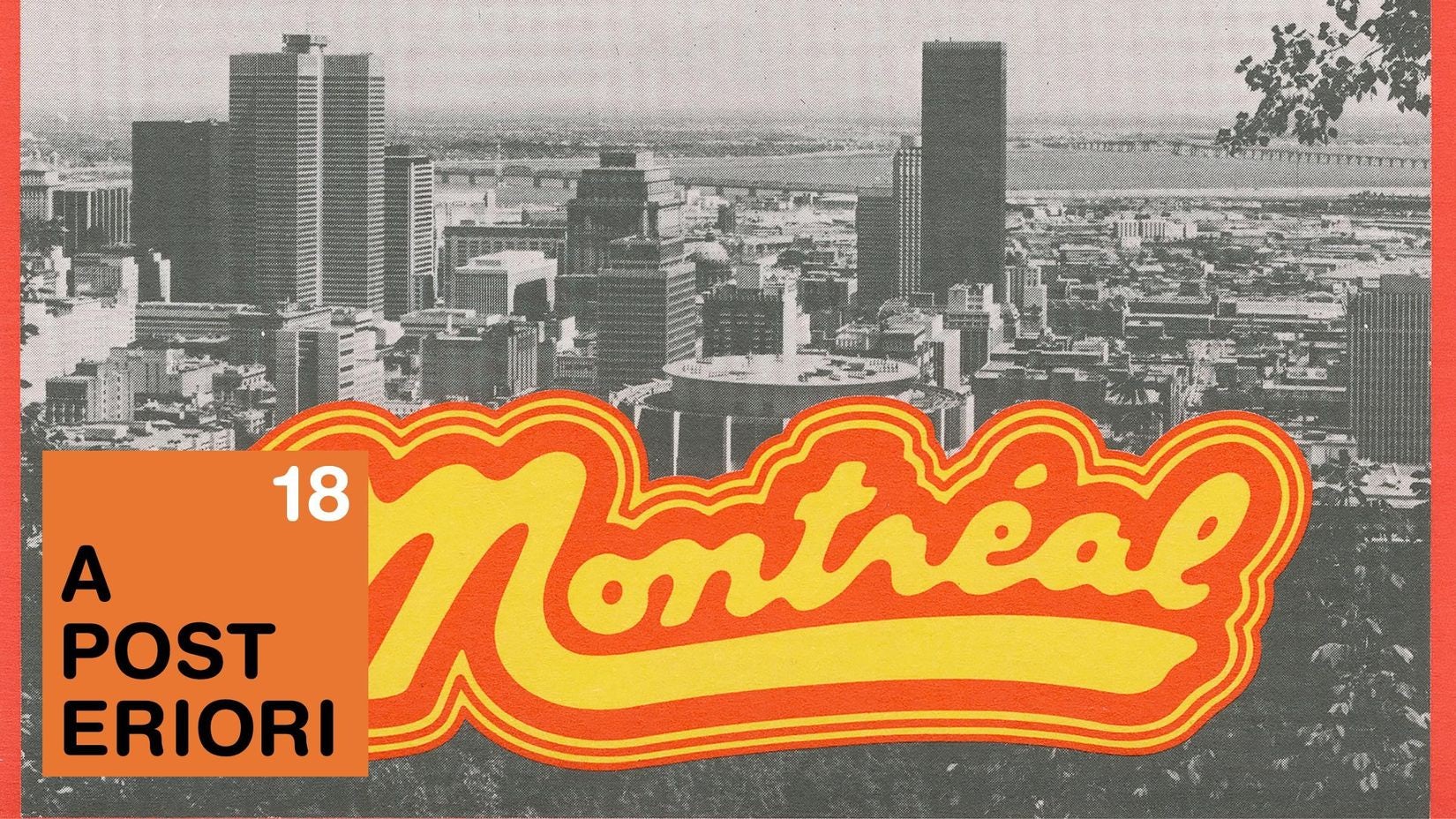
En plus du contexte politique animé, Melvin Charney, alors fervent défenseur d’une identité architecturale montréalaise et d’une « planification intégrée2 », propose un thème qui expose ouvertement la situation précaire et désuète de l’aménagement urbain. Charney, qui s’élève contre un urbanisme décontextualisé (tel que l’édification de la tour de la Maison de Radio-Canada et de la route Transcanadienne), jette un regard critique sur la ville de Montréal tout en se tournant vers un avenir qu’il envisage optimiste.
Voulant confronter les citoyens à cette réalité urbaine qui ponctue leur quotidien, le Musée invite une pluralité de disciplines artistiques à recréer des environnements connus et à effacer les frontières entre l’art et la vie afin que la réflexion se poursuive hors les murs. Dispositifs audiovisuels, performances féministes, plans topographiques, labyrinthe participatif, jeu de simulation urbaine, bandes dessinées et photographies – au final, c’est une cinquantaine de projets originaux qui s’offre au visiteur.
Montréal, plus ou moins ? détient tous les éléments d’une exposition emblématique, tant par la force de sa thématique que par la vitalité artistique de ses propositions. La réception est pourtant partagée. Tour de force selon plusieurs visiteurs, coup manqué pour certains journalistes, bel essai selon quelques artistes ; de bons coups autant que des mauvais demeurent dans les mémoires. Un nouveau regard s’impose, actualisé, qui diffère de l’événement d’origine et qui permet une distance analytique.
Loin de faire dans la nostalgie et sans chercher à encenser l’exposition, la réactivation de Montréal, plus ou moins ? tente d’en comprendre les fondements et les répercussions. Comme l’évoquent Amelia Jones et Adrian Heathfield3 à propos des re-enactments de performances ou d’événements, la reprise d’une exposition a le devoir d’interroger les implications intrinsèques du contexte historique et politique de celle-ci. Suivant cette logique, la réactualisation de Montréal, plus ou moins ? veut contextualiser la pensée des artistes et des organisateurs lors d’une période trouble de l’histoire de la ville et de la projeter quarante-six ans plus tard. Se déploie alors une tension dans la « double historicité »4 de l’événement original et de sa reconstitution. Si l’objectif est de noter l’écart temporel, il s’agit également d’y chercher la continuité, car force est de constater l’actualité des propos des années 1970 ; que ce soit en matière d’aménagement urbain (le déménagement de la Maison de Radio-Canada, prévu pour 2020), de la politique gouvernementale (le retour d’un gouvernement Trudeau en 2015) et évidemment de préoccupations féministes, on remarque que certains enjeux resurgissent de nos jours.
Les documents présentés dans l’exposition de 2018 ont différentes valeurs, mais sont exposés sans hiérarchie, de manière à témoigner d’un morceau d’histoire commune. Traces, archives et partitions partagent le même objectif : dresser un patrimoine et constituer une histoire des expositions. En exposant ces témoins réservés habituellement aux boîtes d’archives, la question de la mémoire est mise au cœur du dispositif de monstration. La mise en exposition constitue ainsi un moment d’activation qui remet cette documentation en circulation et permet de révéler ce qui a disparu puis de raviver cet événement éphémère.
La réactivation de la série de performances du Groupe Mauve par un collectif d’artistes féministes actuelles se veut aussi une négociation entre le passé et le présent, résultat de la performativité des archives. En offrant à Women With Kitchen Appliances (WWKA) la liberté de réinterpréter les actions du Groupe Mauve, il est question d’y ajouter la « voix » des artistes d’aujourd’hui, tout en interrogeant la pérennité de la performance. Il en va d’un processus semblable pour le texte Au cœur de la ville d’André Major, qui sera réinterprété par le comédien et littéraire contemporain Alex Bergeron.
Reconstituer matériellement un événement d’une telle ampleur serait impossible, tant par le nombre élevé d’œuvres, d’artistes et de collaborateurs impliqués que par le passage à l’oubli de certains artefacts. À défaut de pouvoir présenter les œuvres originales de Montréal, plus ou moins ?, la réactivation s’est brodée autour d’une mémoire collective, celle de certains citoyens, artistes ou historiens ayant participé à l’événement en soi ou à ses récits. Cette exposition, incluant notamment des documents inédits, propose d’adopter un regard social et humain face à notre histoire, mais également face aux possibilités offertes par un art responsable et inclusif.
Le projet reçoit l’appui des programmes d’études supérieures en muséologie de l’Université du Québec à Montréal, de Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire et de la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la culture.