
SMITH
Outre
2023.11.23 - 2024.02.03
- Notes
Vernissage
Jeudi 23 novembre à 17 h
En présence de l'artiste et de la commissaireRadio Spirale x USINE C : Identités en mutation
Lundi 20 novembre à 19 h à l'USINE CColloque : Queeriser, dit-on? Questionnements sur les apports des perspectives queers en recherche et en création
Du lundi 20 au vendredi 24 novembre à l'UQAM (IREF)
Dis-moi comment tu racontes, je te dirai à la construction de quoi tu participes. – Isabelle Stengers1
THÉRÈSE ST-GELAIS
Chez SMITH, il n’y a pas de place pour l’assignation et la stabilité. C’est à la fabulation que l’artiste laisse toute la latitude nécessaire pour inventer des récits et proposer des mutations qui déstabilisent notre mode de pensée en le téléportant vers de nouveaux imaginaires.
Difficile de mettre en mots l’indécidable de l’identité, mais aussi la performance d’un « outre-genre » qui prend ses distances avec la conformité. Chez SMITH, l’intelligible se loge dorénavant dans la porosité des frontières et la transition perpétuelle, que Paul B. Preciado appelle de ses vœux.
En même temps que nous sommes dans l’épaisseur de la matière et la transparence des corps captés par les caméras thermiques, nous assistons chez SMITH à un affranchissement des réalités binarisées. Dans ce monde raconté par Vinciane Despret ou Donna Haraway, l’invisible s’invite dans le spectre du visible, vivants et fantômes, humains et non-humains partagent une réalité où soin et curiosité s’expriment à travers des parentés inattendues : un fragment de météorite et une puce électronique qui capture les fantômes sont ainsi implantés dans la chair de l’artiste, dont la pratique des états de conscience non ordinaires lui permet d’accéder à un autre mode de relation et d’hybridation avec ce qui l’entoure.
Dans la multiplicité des savoirs qui se croisent au-delà de leurs limites disciplinaires, à quelle réalité voulons-nous appartenir sans faire l’impasse sur une ouverture toujours reconduite vers la différence ? La fiction s’avérerait-elle plus près de ce que nous attendons et voulons de la réalité ? Comment la résistance à l’assignation d’un genre, de normes, agit-elle sur un mieux-être et un mieux-vivre communs ? Outre l’humain et sa dépendance aux connaissances normalisantes, peut-être y a-t-il des échappées vers une régénération des savoirs plus rassembleuse.
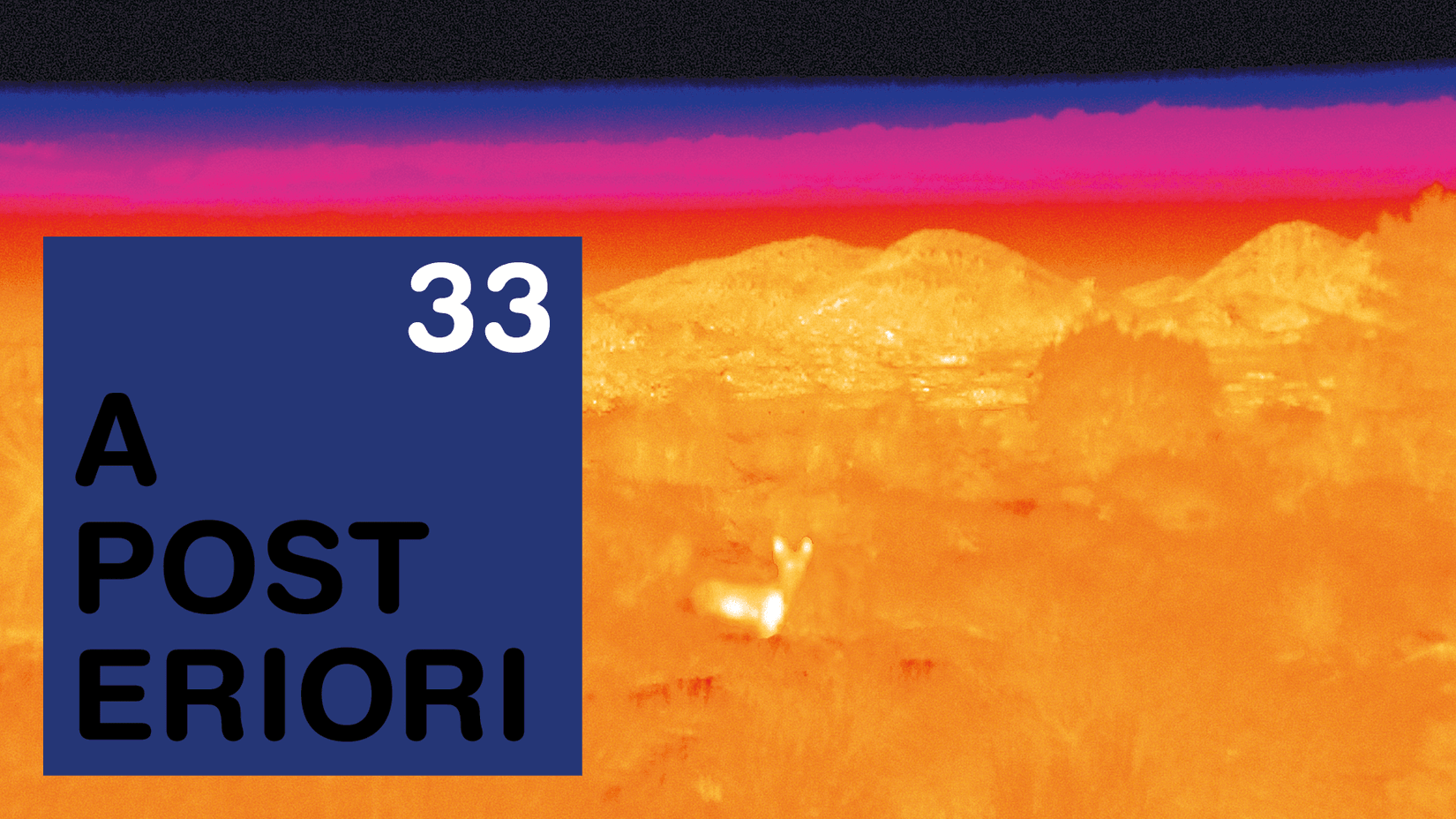
Conversation entre SMITH et Thérèse St-Gelais
THÉRÈSE ST-GELAIS : Toujours, il y a cette traversée lumineuse du vivant, humain, animal, végétal…
SMITH : Il y a, dans les images ici montrées, les images d’une vie entière qui portent la trace d’évolutions, de mues, de bifurcations. Ce que tu décris comme une traversée lumineuse, c’est un cheminement que viennent rythmer plusieurs étapes, rencontres, prises de conscience. C’est une recherche d’une sorte d’essentiel, d’absolu de lumière.
Dans les premiers temps de ma pratique de l’image, j’ai photographié tout ce que j’observais : mes proches, les lieux que je traversais, les animaux que je rencontrais, les arbres que j’admirais, les trajets par la fenêtre des trains que j’empruntais. Mes parents photographes m’ont enseigné que photographier, c’est littéralement « écrire avec la lumière ».
La photographie est pour moi comme un langage silencieux. Chemin faisant, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de différence fondamentale entre faire le portrait d’un ami cher s’endormant au matin après une nuit de fête, celui d’une petite mante-orchidée qui semble danser au creux de notre main, celui d’un arbre tordu par le vent, dont les racines opiniâtres s’accrochent au sable avec espoir, ou celui d’un astre disparaissant dans les plis d’une forêt. Le regard est toujours le même.
T. S-G. : Il n’y a plus de frontière, de bord. On est face à l’infini.
S : Dans ma chair, dans ma vie, je me suis souvent senti en dehors de ces frontières. Masculin/féminin, humain/non humain, visible/invisible, vivant/non vivant, réel/fictionnel, veille/sommeil… Et d’un côté et de l’autre ; ni d’un côté ni de l’autre. Entre les deux. Outre les deux. Outre. Tout court.
Pendant longtemps, j’ai cherché à traduire ce sentiment étrange de se tenir précisément là, c’est-à-dire nulle part : au seuil, à la frontière. Cette impression de se tenir immobile face à l’imminence d’une bascule qui ne vient pas, funambule, à l’extrême bord du précipice. Cela se traduit dans mes images, qui ne posent que des questions irrésolues : qui vois-je sur cette photo ? est-ce un homme, une femme ? dort-il ? veille-t-elle ? quel âge a-t-il, a-t-elle ? depuis quand ?
T. S-G. : Un corps est présent, mais sans identité, désincarné, fantomatique. Que cherche-t-il à nous dire ?
S : Les photographies ne portent pas de titre. Ni les corps ni les lieux n’y sont nommés, les dates ne sont mentionnées qu’à titre d’archivage. Ce n’est pas l’identité réelle, fixée par l’administration, ni l’âge, l’origine, l’histoire personnelle ou les singularités des personnes photographiées qui guident ces images. C’est plutôt la continuité de l’affection – parfois de l’amour – que je ressens pour ces êtres, qui se manifestent dans le flot des corps de toute espèce qui semblent naître sur une image et se poursuivre sur la suivante, sous une autre forme.
Ces photographies sont rarement mises en scène ; elles sont sélectionnées au sein d’un flux de photographies où peu à peu s’est composée une vision : celle de la possibilité, à travers la matière même de l’image, son grain, ses nettetés impossibles, ses écrans de fumée, ses couleurs en lavis, de raconter une rencontre entre des « différants », pour composer un chant d’amour à un vivant métamorphique et étoilé. Un vivant qui se tient « entre », avec une telle ferveur que la frontière s’effrite sous son poids, révélant des continuités, des spectres, des flux, plutôt que des catégories.
T. S-G. : Que de l’organicité, de la transitivité. Que des états de passage. Aucune assignation.
S : Il m’importe en effet de défaire le corps de ses assignations et des systèmes de domination dans lesquels il est englué. Cela se fait en composant, avec des images, un corps autre, un corps hybridé, un corps fait de mille corps, un corps étoilant vers une infinité d’autres corps, d’autres possibles, d’autres chaleurs, d’autres vies.
D’un premier mouvement de création où il s’agissait de se tenir dans un instant suspendu, je suis passé à un second mouvement qui a porté plus loin cette intuition.
Cela s’est manifesté à travers ma rencontre avec des techniques et des technologies qui m’ont donné la sensation d’avoir accès à un monde plus grand, à une réalité plus vaste. Il y a eu d’abord la découverte de la caméra thermique. Cet appareil photo créé par et pour l’armée américaine après la Seconde Guerre mondiale offre à nos yeux humains une autre vision : celle que nous appelons « invisible », mais à laquelle d’autres yeux, comme ceux des serpents, ont accès. Cet invisible, nous pouvons le détecter avec un autre de nos sens : le toucher. Ce que nous percevons comme de la chaleur est en réalité une partie du spectre visible trop lointaine pour être détectable par nos yeux. Cette caméra me permet d’avoir accès à ce que j’appelle des fantômes : des traces laissées par des corps qui étaient là, il y a un instant, il y a mille ans, et dont l’énergie thermique demeure.
T. S-G. : Ces personnes en état second, en crise de sommeil, d’où viennent-elles ? Où veulent-elles aller ?
S : J’ai fait la découverte des états non ordinaires de conscience, à travers la pratique de la méditation transcendantale, de la transe cognitive auto-induite et de la médecine amazonienne dans la jungle péruvienne.
J’explore aussi les états de corps suspendus, transitifs, que permettent les avancées biotechnologiques.
D’abord, avec les traitements hormonaux utilisés dans le cadre d’une transition de genre, qui offrent au corps une nouvelle mue, un lent passage d’un monde à l’autre.
Ensuite, avec la découverte des vols paraboliques : j’ai volé dans un avion qui effectue des paraboles au-dessus de l’océan en alternant montées et descentes espacées de paliers, recréant pour les passagers l’état d’apesanteur pendant 22 secondes. Pendant ces 22 secondes répétées des dizaines de fois, notre corps n’est plus soumis à l’assignation à la gravité terrestre : nous flottons, comme les astronautes, sans ressentir le poids du corps.
Et puis, toujours, avec la vision de l’invisible qu’offre la caméra thermique.
Grâce à ces technologies anciennes ou ultramodernes, les choses et les êtres se révèlent dans un espace aux potentialités infinies : nous vivons et rêvons sur un grand spectre dont les pôles, inatteignables, partent dans toutes les directions.
Un spectre tentaculaire, chtulucénique, aux multiples pôles, ouvrant la possibilité d’une position contestant les cloisonnements, les scléroses, les discriminations, les dominations d’un pôle sur l’autre. Un spectre où la multipolarité remplace la bipolarité, où l’« entre » remplace « l’entre-deux ». Un « outre », qui étoile vers de multiples au-delàs.
T. S-G. : Pourquoi toujours ce besoin de voir dedans, de voir au travers – en transparence ?
S : Le travers, la transparence, c’est toujours déjà du « trans », un préfixe latin qui donne le sens de passer d’ici à là, passer à travers, passer outre.
Comme une traversée qui est elle-même un vaisseau, comme le vaisseau Terre que nous habitons et qui est notre véhicule dans l’univers en expansion. Habiter ce qui trans, ce qui outre, voir à travers, c’est faire sien l’état indéfini de ce qui se tient « entre ». C’est se laisser traverser. Devenir ce qui transe, ce qui spectre, ce qui hante, ce qui traverse, ce qui cahote, ce qui mute, ce qui mue en nous.
Le travail de la transparence, dans mes images, vidéos et sculptures, vient inviter à cette grande mue, à ce grand strip-tease qui révèle un corps superlumineux, traversé de mille flux.
T. S-G. : Du réel ou de la fabulation ?
S : C’est à nous d’inventer le monde que nous souhaitons voir advenir. Cela passe par des pratiques de vie, mais aussi par la culture de notre imaginaire. Enfant, je regardais en boucle le film L’histoire sans fin, réalisé par Wolfgang Petersen et sorti en 1984. Un petit garçon solitaire, sans doute comme moi autiste et plongé sans cesse dans un monde intérieur fait de rêves, de fictions, de relations incomprises avec des créatures non humaines réelles ou imaginaires, se réfugie un matin dans une librairie pour échapper à des garçons de sa classe qui le persécutent. Il y fait la rencontre fortuite avec un livre, L’histoire sans fin, dont il deviendra le protagoniste au fur et à mesure de sa lecture, s’apercevant que son rôle est de continuer à rêver pour maintenir en vie un autre monde nommé Fantasia.
Fantasia est le monde de la fantaisie et de l’imagination humaine, et avec la mort de nos rêves, avec la mort de nos nuits, la disparition des étoiles, l’emprise toxique de l’humain sur le reste du monde, l’arraisonnement systématique de l’autre sur terre et dans le cosmos, ce monde se meurt. Il en va de même au-delà de la fiction.
Nous détruisons notre monde. Notre monde brûle.
Mes images invitent au désir infini, au respect de l’autre (humain, non-humain, cosmos…) dans son opacité, au développement de relations, d’affections, d’hybridations, de transitivité, de traversées. Elles invitent à engager des discours critiques, des pratiques artistiques, dans un continuum de pensée, de savoirs, de créations. Elles invitent, j’espère, à composer de nouvelles mythologies.
Écouter la conversation entre SMITH et Thérèse St-Gelais (8 min 43 s)
Cette exposition est rendue possible grâce au soutien de l’Institut français à Paris.